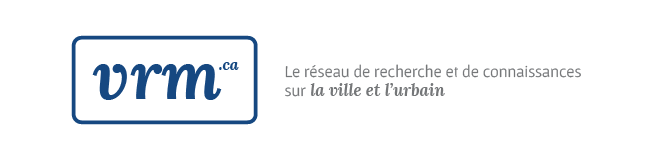par Salomé Vallette | Avr 9, 2023 | # Midis de l’immigration
Cette conférence portait sur les résultats de recherche doctorale de Maude Marquis-Bissonnette, professeure à l’ENAP à Gatineau, autour de la question : comment les communautés locales à l’échelle des villes du Québec accueillent-elles et intègrent-elles les immigrants et les immigrantes? Deux grandes villes du Québec sont à l’étude : Québec et Gatineau.
par Salomé Vallette | Jan 25, 2023 | # Midis de l’immigration
Conférence de Hiên Pham, professeure agrégée à l’UQÀM, Nathalie Boucher, directrice et chercheuse chez Respire et Beverly Jacques, Ambassadeur du Vivre ensemble Saint-Léonard.
Saint-Léonard est un arrondissement de la Ville de Montréal qui fait face à d’importants changements démographiques et culturels et où il existe, à l’instar d’autres arrondissements limitrophes, des enjeux de cohabitation. À Saint-Léonard, la particularité réside dans le fait qu’une importante population jeune (entre 0 et 25 ans) et aînée (80 ans et plus) s’y côtoie quotidiennement. Ces deux groupes d’âge, situés aux deux pôles, ont chacun des besoins spécifiques, ce qui pose des défis importants, en particulier pour l’accès à l’espace public, dans un lieu historiquement pensé pour la voiture.
par Valérie Vincent | Jan 17, 2022 | # Midis de l’immigration
Les populations subsahariennes empruntant les routes migratoires vers l’Europe sont l’objet d’un processus de racialisation qui les réduit à être porteuses d’une couleur de peau. C’était l’idée principale défendue par Mustapha El Miri, maître de conférences au département de sociologie de l’Université Aix-Marseille, lors de la conférence des Midis de l’immigration, le 26 octobre 2021. S’appuyant sur une enquête terrain réalisée au Maroc, en Espagne et en France de 2014 à 2018, le conférencier soutient que ces formes de racisme subies par les migrants subsahariens sont invisibilisées scientifiquement et politiquement et qu’elles se déploient dans les relations sociales quotidiennes.
par Valérie Vincent | Nov 18, 2021 | # Midis de l’immigration
Il est acquis que l’immigration présente de nombreux défis dont les impacts se font ressentir sur la vie intime et familiale des personnes évoluant dans cette trajectoire. C’est autour des enjeux touchant la construction de projet de vie commun, au fil du parcours migratoire, que reposent les recherches menées par les deux conférencières.
par Valérie Vincent | Sep 2, 2021 | # Midis de l’immigration
Alors que la sociologie de l’immigration puise dans de nombreuses disciplines (science politique, démographie ou économie), le champ des pratiques artistiques et culturelles quant à lui permet de jeter un nouvel éclairage sur nos compréhensions des expériences migratoires. Le Midi de l’immigration du 22 avril 2021 intitulé Ce que les arts et la culture révèlent de l’expérience migratoire visait précisément à interroger les postures méthodologiques et les réflexions sociologiques émanant du croisement entre sociologie de l’immigration et sociologie de l’art et de la culture.
par Valérie Vincent | Juin 15, 2021 | # Midis de l’immigration
En 2019, l’Observatoire des personnes déplacées à l’interne évaluait à plus de 17 millions, le nombre de personnes ayant dû se déplacer en 2018 suite à une catastrophe environnementale. Toutefois, la question des migrations internationales dues aux changements climatiques reste un sujet peu exploré.